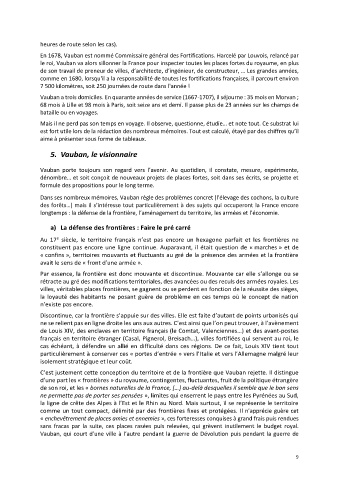Page 9 - CONFERENCE ''VAUBAN, VISIONNAIRE ET HUMANISTE'' PAR JEAN-MARIE ROUECHE
P. 9
heures de route selon les cas).
En 1678, Vauban est nommé Commissaire général des Fortifications. Harcelé par Louvois, relancé par
le roi, Vauban va alors sillonner la France pour inspecter toutes les places fortes du royaume, en plus
de son travail de preneur de villes, d’a hite te, d’i g ieu , de constructeur, … Les grandes années,
comme en 1680, lorsqu'il a la responsabilité de toutes les fortifications françaises, il parcourt environ
7 500 kilomètres, soit 250 journées de route dans l'année !
Vauban a trois domiciles. En quarante années de service (1667-1707), il séjourne : 35 mois en Morvan ;
68 mois à Lille et 98 mois à Paris, soit seize ans et demi. Il passe plus de 23 années sur les champs de
bataille ou en voyages.
Mais il ne perd pas son temps en voyage. Il observe, questionne, tudie… et note tout. Ce substrat lui
est fort utile lors de la rédaction des nombreux mémoires. Tout est calculé, étayé par des chiffres u’il
aime à présenter sous forme de tableaux.
5. Vau a , le visio ai e
Vau a po te toujou s so ega d ve s l’ave i . Au quotidien, il constate, mesure, expérimente,
d o e… et soit o çoit de ouveau p ojets de pla es fo tes, soit da s ses its, se p ojette et
formule des propositions pour le long terme.
Dans ses nomb eu oi es, Vau a gle des p o l es o et l’ levage des o ho s, la ultu e
des forêts… ais il s’i t esse tout pa ti uli e e t à des sujets qui occuperont la France encore
longtemps : la défense de la frontière, l’a age e t du te itoi e, les a es et l’ o o ie.
a) La défense des frontières : Faire le pré carré
e
Au 17 si le, le te itoi e f a çais ’est pas encore un hexagone parfait et les frontières ne
constituent pas encore une ligne continue. Auparavant, il était question de « marches » et de
« confins », territoires mouvants et fluctuants au gré de la présence des armées et la frontière
avait le sens de « front d'une armée ».
Par essence, la frontière est donc mouvante et discontinue. Mouvante car elle s’allo ge ou se
rétracte au gré des modifications territoriales, des avancées ou des reculs des armées royales. Les
villes, véritables places frontières, se gagnent ou se perdent en fonction de la réussite des sièges,
la loyauté des habitants ne posant guère de problème en ces temps où le concept de nation
’e iste pas e o e.
Dis o ti ue, a la f o ti e s’appuie su des villes. Elle est faite d’auta t de poi ts u a is s ui
ne se relient pas en ligne droite les uns au aut es. C’est ai si ue l’o peut t ouve , à l’av e e t
de Louis XIV, des enclaves en territoire français (le Comtat, Vale ie es… et des ava t-postes
français en territoire étranger (Casal, Pignerol, Breisa h… , villes fo tifi es ui se ve t au oi, le
cas échéant, à défendre un allié en difficulté dans ces régions. De ce fait, Louis XIV tient tout
pa ti uli e e t à o se ve es « po tes d’e t e » ve s l’Italie et ve s l’Alle ag e alg leu
isolement stratégique et leur coût.
C’est juste e t ette conception du territoire et de la frontière que Vauban rejette. Il distingue
d’u e pa t les « frontières » du royaume, contingentes, fluctuantes, fruit de la politique étrangère
de son roi, et les « o es atu elles de la F a e, […] au-delà desquelles il semble que le bon sens
ne permette pas de porter ses pensées », limites qui enserrent le pays entre les Pyrénées au Sud,
la lig e de te des Alpes à l’Est et le Rhin au Nord. Mais surtout, il se représente le territoire
comme un tout compact, délimité par des frontières fixes et protégées. Il ’app ie gu e et
« enchevêtrement de places amies et ennemies », ces forteresses conquises à grand frais puis rendues
sans fracas par la suite, ces places rasées puis relevées, qui grèvent inutilement le budget royal.
Vauban, qui ou t d’u e ville à l’aut e pe da t la gue e de D volutio puis pe da t la guerre de
9